Paul Jacqmarcq, professeur de Philosophie, est l’auteur de l’ouvrage présenté ci-dessous, disponible ici. Dans son propos, il rappelle à quel point les chantres de la « représentation » ont pu être des anti-démocrates, résolument engagés, ensemble, contre la majorité-masse. Ici, vous trouvez un extrait de son ouvrage. Son ouvrage contribue à bien distinguer ces notions transversales, à la fois politiques, historiques, philosophiques, distinction devenue d’une importance capitale dans la situation française, et au-delà.
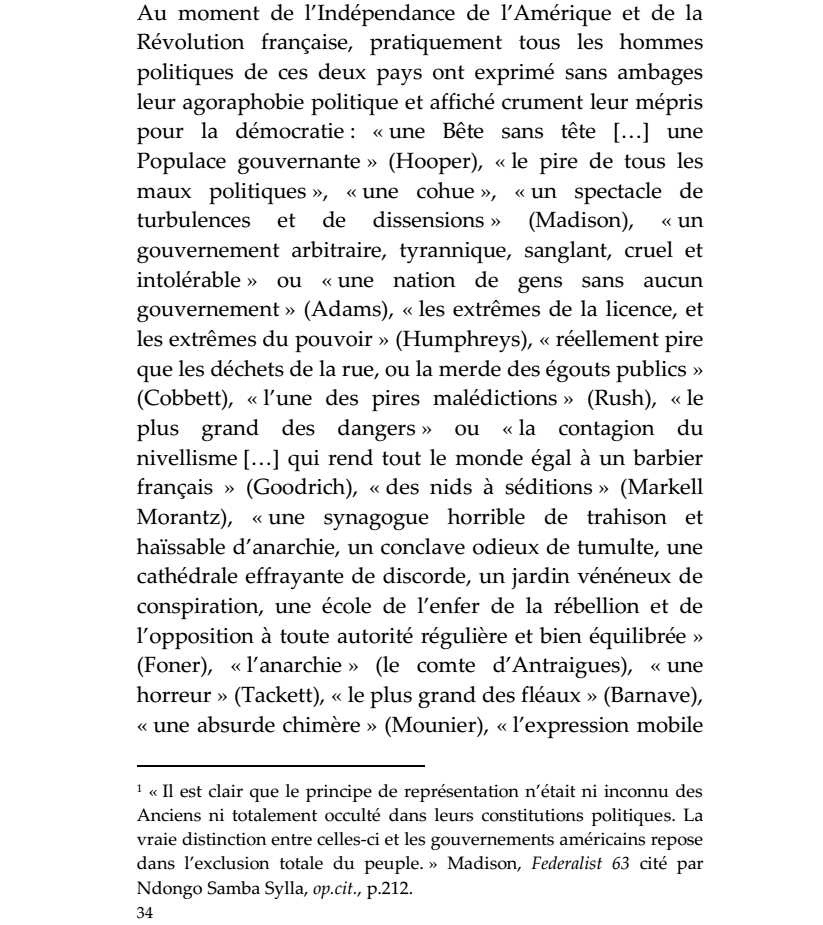

- La première partie du livre commence par deux citations : « L’ignorance de la signification des mots, c’est-à- dire le défaut de compréhension, dispose les hommes à recevoir de confiance non seulement la vérité qu’ils ne connaissent pas, mais aussi les erreurs, et qui plus est, les non-sens de ceux à qui ils font confiance. Car l’erreur ni le non-sens ne peuvent être décelés sans une parfaite compréhension des mots. » (Hobbes, Léviathan) et « L’abus des mots a toujours été un des principaux moyens qu’on a employés pour asservir les peuples. » (Élisée Loustalot, Les Révolutions de Paris). Or, dans la foulée de ces références, vous proposez, pour parler de démocratie, véritable, un néologisme, la « démarchie« , puis deux expressions, « force coercitive populaire », ou le « règne violent du peuple ». Comment justifiez-vous ce mots, ces expressions, notamment celles-ci, qui font systématiquement référence à la force ? Pourquoi faut-il, même à un bon régime, de la « force », des forces ?
Oui, je crois en effet qu’en politique, les mots sont des étendards. Il existe une lutte pour conquérir le monopole de certains mots, certaines valeurs, certains principes que chaque camp désire incarner. Aujourd’hui, par exemple, quel homme politique pourrait se prétendre « non-démocrate » ou « anti-démocrate », quel parti pourrait se présenter comme « non-démocratique » ? Le mot « démocratie » est devenu l’étendard du bien en politique. Mais cela n’a pas toujours été le cas dans notre histoire, nous y reviendrons sans doute plus tard.
Ainsi, faire de la philosophie politique consiste notamment à prendre du recul sur le sens des mots, en analysant par exemple l’histoire de leur valorisation ou, au contraire, de leur dévalorisation. Pour un camp, utiliser un mot connoté positivement et parvenir à l’associer aux siens, est un gage de popularité et cela facilite ainsi son accession ou bien son maintien au pouvoir. C’est un facteur crucial de propagande si vous voulez. Déceler ce stratagème, montrer comment l’utilisation de certains mots peut, à elle seule, empêcher telle ou telle émancipation, ou au contraire justifier telle ou telle exploitation est ainsi un enjeu hautement philosophique. Par exemple, en tant qu’enseignant, faire croire à ses élèves que l’organisation de l’élection des délégués est un processus démocratique, c’est-à-dire associer la notion d’élection à celle de démocratie dans une évidence béate est selon moi une grave erreur. Donc, oui : j’essaie de faire tout simplement œuvre de philosophie en questionnant le sens des mots.
De manière pas très originale, j’ouvre en effet ma réflexion sur l’analyse étymologique du terme « démocratie ». Tout le monde le sait : le mot vient du grec démos et kratos. On entend souvent qu’ainsi démocratie signifierait « gouvernement du peuple ». Or, en grec, « gouvernement » se dit archè, alors que kratos signifie « pouvoir ». Donc, en toute rigueur, si on associe la démocratie au gouvernement du peuple, il faudrait plutôt parler, comme vous le rappelez dans votre question, de « démarchie ».
Deux chemins s’ouvrent alors. On pourrait tout d’abord utiliser ce nouveau terme d’un point de vue stratégique, justement pour se différencier de la « démocratie », mot valise aujourd’hui qui n’a plus grand sens. En plus, on entend « démarche », comme s’il fallait remettre en marche le processus du gouvernement populaire. Cela pourrait être très « marketing » ! Mais à l’heure où la Macronie s’est identifiée au commencement à « La République en Marche », c’est peut-être maladroit… Je préfère la deuxième voie : faire entendre le véritable sens du mot « démocratie » lorsqu’il est utilisé à Athènes au Vème siècle av. J.C., quitte à ce qu’on le confonde avec la bouillie actuelle. Revenir au sens originel, c’est justement insister sur le kratos : non pas un « gouvernement » mais un « pouvoir », c’est-à-dire, comme l’explique fort justement Ndongo Samba Sylla dans La démocratie contre la République, en effet une « force coercitive » qui s’exerce, un « règne » qui peut être « violent ».
Mais un pouvoir de qui et sur qui ? Car si on associe un terme à la violence, c’est forcément pour le dévaloriser, pour le critiquer, pour remettre en cause sa légitimité. Qui donc pouvait bien souffrir d’un tel pouvoir et l’associer du coup à une force de coercition illégitime ? Tout simplement, tous ceux qui, à cause de la démocratie, vont perdre leur propre pouvoir, leurs propres privilèges, leur statut d’élite : tous ceux qui ont l’habitude d’incarner le magistère de la pensée et le monopole de la domination. C’est eux qui vont souffrir du pouvoir du démos, ils le savent bien. De leur point de vue, le démos, c’est la populace, l’immonde majorité des plus pauvres. En effet, on ne se rend compte du pouvoir qui s’exerce sur nous seulement lorsqu’on en souffre ! L’arbitraire de la décision de rallonger de deux ans la durée de temps de travail, par exemple, ne se vit pas de la même manière pour un enseignant ou pour un ouvrier en bâtiment : le second ressent bien plus intensément le pouvoir qui s’exerce sur lui car il va bien plus souffrir de ce nouveau décompte. Alors oui, il faut entendre derrière ce mot aujourd’hui si lisse, si consensuel de « démocratie », un régime qui bouleverse l’ordre établi qui profite à une minorité, une réelle alternative à toutes les oligarchies qu’elles soient monarchiques, claniques, religieuses ou bourgeoises. Rompre avec un ordre nécessite une forme de coercition.
Je préfère donc rendre son caractère révolutionnaire au mot « démocratie » : non pas le synonyme de nos régimes oligarchiques mais au contraire l’espoir d’une alternative égalitaire. Et la démocratie ne provenant pas de rien et n’étant pas synonyme d’harmonie universelle, la force n’en serait pas exclue, même si elle serait amplement euphémisée par rapport à nos régimes actuels.
- Tant de livres, savants, scolaires, font référence au régime, provisoire, d’Athènes, qualifié en tant que « démokratos », mais peu en présentent les caractéristiques. Dans le livre, vous rappelez qu’il y a un ensemble, entre des droits, des devoirs (participation à des prises de décision, à l’élaboration de décisions), et que, malgré tout cela, « seulement environ 20% des citoyens siégeaient à l’Assemblée. ». Par conséquent, nous avons beaucoup de mal à comprendre pourquoi, par comparaison avec notre situation, Athènes était infiniment plus, vraiment, démocratique que notre propre système, français, et, en même temps, pas vraiment démocratique, puisqu’elle ne l’était pas totalement. Quel tableau faites-vous de ce régime ?
Pour répondre à votre question, il faut distinguer deux choses : l’ambition du projet et sa réalisation concrète. Bien-sûr, on peut insister sur toutes les entorses aux grands principes de la démocratie qui existaient à Athènes pendant la période de la démocratie (508-322 av J.C.). On peut par exemple critiquer le statut d’alors de citoyen qui n’était accessible qu’à environ 30.000 Athéniens qui excluait ainsi la majeure partie de la population (environ 220.000 enfants, femmes, esclaves et métèques). Cela est à l’évidence en contradiction avec le principe d’égalité si cher à un régime démocratique. Ce type d’objection qui consiste à remettre en cause le caractère véritablement démocratique du régime athénien est souvent – je ne pense pas que cela soit votre cas – un moyen de dire : « En fait, la démocratie, ce n’est pas possible, c’est toujours une forme d’élite qui gouverne. Tout pouvoir est nécessairement aristocratique. Regardez, même à Athènes, seule une minorité gouvernait. » Certes, comme nous y reviendrons sans doute plus tard, tout pouvoir cherche à se faire passer pour nécessaire et donc à nous faire oublier qu’on pourrait se passer de lui. Ainsi, nous sommes conditionnés à ne pas croire en notre capacité collective de nous organiser par nous-mêmes, à nous passer de chef. Cela nous rassure donc de nous dire que finalement, même à Athènes, ils n’ont pas vraiment réussi non plus.
Pourtant, on peut voir les choses autrement : premièrement le génie des penseurs athéniens de l’époque nous permet de définir les grands principes de la démocratie, deuxièmement l’expérience concrète, quoiqu’imparfaite, reste inégalée. Voilà pourquoi Athènes demeure un modèle pour les démocrates. Par exemple, le principe que dans une démocratie « chaque citoyen est tour à tour gouverné et gouvernant » (Aristote) est fondateur et peut être repris aujourd’hui en incorporant au statut de citoyen les femmes, les jeunes à partir de 18 ans, et pourquoi pas les étrangers vivant sur notre sol ? Quant à leur pratique concrète de la démocratie, si effectivement seulement « 20% des citoyens pouvaient siéger à l’Assemblée du Peuple » comme vous le rappelez, cela faisait tout de même bien davantage que nos députés et sénateurs actuels, d’autant qu’ils ont bien moins de pouvoir qu’à l’époque ! Sachant de plus qu’on ne parle ici que des citoyens athéniens qui siégeaient à l’Assemblée, mais il y a aussi tous ceux qui siégeaient à la Boulè (500 citoyens) ainsi que tous les citoyens tirés au sort qui participaient à la troisième institution majeure : le Tribunal du Peuple. Ce qui fera dire à l’historien Hansen, le plus grand spécialiste de la démocratie athénienne : « Le niveau de l’activité politique des citoyens d’Athènes n’a aucun équivalent dans l’histoire universelle, que ce soit en nombre, ou en taux de participation. »
- Vous démontrez dans cet ouvrage que, jusqu’il y a peu, la « démocratie » était massivement rejetée par les « gens importants », et pour cela, vous accumulez des citations terribles, qui démontrent un racisme social structurel, violent, de ces personnes, américaines, françaises, envers le peuple. Ils expriment un autre versant de l’esclavagisme, à savoir qu’ils prétendent justifier qu’ils ont, eux, le droit, comme le devoir, d’assumer les « responsabilités du pouvoir », et que le peuple est là pour obéir, servir, point. Et vous indiquez que les intellectuels européens, notamment les philosophes, se sont associés à l’expression de cette idéologie. C’est ce qui expliquerait que, selon vous, la démocratie n’a pas existé dans le passé, mais pourrait enfin exister à l’avenir, si… ? Comment comprendre que les intellectuels aient été, à rebours de la réputation qu’ils se donnent ou qu’on leur donne, bien plus suivistes qu’éclaireurs ? Que, notamment, la pensée philosophique ait pu être si soumise à une idéologie dominante ?
Commençons par la fin de votre question. Eh oui, c’est malheureux de constater que les philosophes ne sont pas toujours de libres penseurs et que, bien trop souvent, ils ne font que répéter la pensée hégémonique de leur époque. En termes de misogynie, par exemple, c’est bien connu ! Et en ce qui concerne le domaine politique, les philosophes de notre tradition sont pratiquement tous anti-démocrates. On en arrive alors au paradoxe suivant : comment une tradition de pensées anti-démocratiques a-t-elle pu accoucher de l’évidence actuelle du bien fondé de la démocratie ? Il y a de nombreuses raisons : la principale tient sans doute à leur appartenance à des couches privilégiées de la population, et donc à la fois à un certain habitus aristocratique et à une méconnaissance du peuple.
Du point de vue de l’élite, le peuple est – doit être – toujours incapable de gouverner. Cette opinion est une condition nécessaire à la domination du groupe social auquel ils appartiennent : ils ne peuvent pratiquement pas penser autrement, sinon ce serait reconnaître que leur supériorité n’a pas de légitimité. Ainsi, logiquement, ils contestent pratiquement tous (à quelques exceptions près comme Spinoza ou Rousseau) le régime démocratique. Et si après que la bourgeoisie a pris le pouvoir, le fait de se présenter comme « démocrate » est un moyen de se faire élire, il n’en reste pas moins que l’élite reste persuadée de l’incapacité du peuple à pouvoir s’autogérer. On en arrive ainsi à la situation actuelle où, au nom de la démocratie, on tue la démocratie : la dernière réforme des retraites en est l’illustration parfaite. Que les dirigeants politiques (Sieyes, Madison) ou que les philosophes (Platon, Kant) contestent la vraie démocratie ou bien que d’autres, plus récents comme Thiers, Macron ou Finkielkraut vantent les mérites de la fausse démocratie, c’est-à-dire le gouvernement représentatif ou la République, c’est toujours pour la même raison : pour reprendre l’expression de Dupuis-Déri, c’est à cause de leur agoraphobie, c’est-à-dire leur peur du peuple rassemblé qui fait de la politique, qui discute de l’organisation de la société de manière autonome. Encore une fois : reconnaître cette capacité, c’est perdre leur supériorité et ainsi la justification de leur pouvoir.
Pour répondre à un autre aspect de votre question, je ne sais pas si j’explique pourquoi la démocratie n’a jamais vraiment eu lieu dans l’histoire, ce serait ambitieux de penser cela de mon petit livre, mais je peux sans doute participer à ouvrir des pistes pour y réfléchir, oui ça je l’espère. Avoir la prétention d’exercer un pouvoir, c’est toujours partir de l’idée de sa propre supériorité. A contrario, se soumettre à un pouvoir, c’est toujours reconnaître son infériorité, d’une manière ou d’une autre, son incapacité à gouverner. L’absence de démocratie n’est que l’envers du trop plein de pouvoir. Alors comment sortir de ce cercle qui fait de l’acceptation de l’impuissance des uns la légitimité de la puissance des autres ? C’est d’une certaine manière ce que vous me demandez aussi dans votre question. Je répondrais : lorsque le pouvoir faillit trop, lorsque l’illusion ne fonctionne plus et qu’on n’y croit plus. Lorsque la qualité mise en avant par les détenteurs du pouvoir se révèle suffisamment illusoire pour qu’une partie de la population (sans doute pas la majorité, une minorité suffit) ne croit plus en leur légitimité. Et là, patatra ! En un quart de seconde, « Sa Majesté Louis XVI » devient « Citoyen Louis ». Cela n’est pas synonyme d’avènement de la démocratie – comme on le sait pour la Révolution française, par exemple, qui n’a accouché que d’un gouvernement bourgeois – mais peut tout de même nous en rapprocher.
- Pour présenter l’originalité de ce que serait, enfin, une démocratie, vous la comparez, à sept formes de pouvoir, en lien avec ce que dit Platon dans Les Lois, à propos des titres de ceux qui sont au pouvoir. Quelles sont ces formes, et, par comparaison, pourquoi la démocratie est si singulière, si rare, si difficile à mettre en œuvre ?
Platon énumère en effet dans ce fameux extrait (689-690) les différents titres dont se parent ceux qui exercent un pouvoir (au sein d’une famille ou dans la société) pour justifier leur ambition ou leur supériorité. Ils sont, comme vous le rapportez, au nombre de sept. Je me rapporte ici directement à l’analyse qu’en fait Rancière dans La haine de la démocratie. Les quatre premiers titres se rapportent à la naissance : commandent naturellement ceux qui sont nés avant (la parentalité fonde l’autorité parentale et l’ancienneté la gérontocratie) ou mieux nés (la richesse fonde la ploutocratie et la propriété l’esclavagisme). Les deux suivants se rapportent à la loi de la Nature : la force avec la dictature et le savoir avec la technocratie : dans les deux cas, le meilleur (une forme d’aristocratie). Cette liste de « titres » de Platon n’est évidemment pas exhaustive, on pourrait ajouter la sainteté (théocratie), la filiation (monarchie) ou bien l’élection (république). Il s’agit, dans tous les cas, de dire qu’une caractéristique nous autorise à être supérieurs aux autres, nous donne le droit de donner des ordres, de créer une inégalité et donc de former une oligarchie, une confiscation du pouvoir par quelques-uns.
Il existe cependant une exception nous dit Platon : un pouvoir qui n’aurait pas besoin de titre, une caractéristique nous autorisant à confisquer le pouvoir. Pour cela, il faudrait concevoir un pouvoir pour lequel il n’y aurait pas de séparation entre ceux qui l’exercent et ceux sur qui il s’exerce. Ce pouvoir s’appelle la démocratie, le pouvoir de n’importe qui, le pouvoir des sans-titres. Il s’agit du septième titre du texte de Platon, fondé sur le principe de l’égalité politique (cf. Aristote « Chacun tour à tour est gouvernant et gouverné »), un titre qui n’en est pas un, le titre qui disqualifie tous les titres : le hasard.
Ainsi, on comprend que l’exercice du pouvoir, s’il n’est pas démocratique, consiste à faire oublier le seul principe qui peut le légitimer réellement : l’égalité politique. Pour le dire autrement : faire accepter l’idée que la possession d’un titre est nécessaire à l’exercice du pouvoir. Si « la démocratie est si difficile à mettre en œuvre » pour reprendre votre question, c’est donc que tous les pouvoirs sont sans cesse en train de persuader leur peuple de leur incapacité à s’autogouverner. Par exemple, l’idée que tous les gouvernements ressortent dès qu’ils sont critiqués par des mouvements sociaux : « sans l’État, ce serait la guerre civile » (idée qui a sa source philosophique dans les théories du contrat de Hobbes, Locke et Rousseau). L’idée, elle aussi très répandue, que « la IVème République, en étant parlementaire, était inefficace » induit là encore la nécessité d’un pouvoir central, resserré autour de quelques personnes. Ce que j’essaie de montrer dans mon livre, c’est que l’école participe à ce façonnement de notre impuissance par le biais de l’élection des délégués. Dès le primaire, on nous fait élire des représentants de classe, comme si tous les élèves n’étaient pas égaux pour représenter leurs camarades. Difficile de se défaire ensuite de la croyance en notre propre impuissance…
- Votre ouvrage fait partie de ces livres qui démontrent qu’il est impossible de confondre système représentatif et démocratie. Vous démontrez, comme d’autres, que ceux qui ont mis en place au 18ème siècle notamment, des systèmes représentatifs étaient clairement et radicalement des anti-démocrates. Or le système français actuel en est un exemple précis, et terrible. Pourquoi ?
Il me semble que pour répondre à votre question, il faut réfléchir à ce qu’on entend par « faire de la politique » ? Qu’est-ce qu’un homme politique dans une vraie démocratie, en le distinguant de celui de nos républiques ? Dans une démocratie, le citoyen tiré au sort ou élu n’est pas celui qui va décider. Il ne faut pas plaquer nos propres habitudes sur un régime proprement démocratique. Un homme politique n’est pas un « décideur » comme on dit. Ce n’est pas celui qui tranche dans un sens, parce qu’il serait supérieur, grâce à tel ou tel titre. Ce n’est pas « le pilote du navire » comme dirait Platon. Il (elle) n’est qu’un(e) citoyen(ne) parmi d’autres participant à l’élaboration et au vote de décisions collectives, dans la limite des fonctions de chaque assemblée, à tous les niveaux (local, départemental, régional, national). Dans une démocratie, il n’y a pas de « représentant » : il y a soit des mandataires élus soit des citoyens actifs qui travaillent collectivement. Ce qui doit être « représentative », c’est la composition de chaque assemblée, c’est-à-dire à l’image du quartier, de la ville, du pays etc.
Ainsi, lorsque ces citoyens ou ces citoyennes sont choisis, ils ont plutôt conscience de leur manque de savoir sur la question ou le sujet auxquels l’assemblée est confrontée. A l’inverse du politicien professionnel, ils ne partent pas du présupposé qu’ils savent, qu’ils sont compétents, du fait de leur formation et car ils ont toujours voulu décider pour les autres. Ils sont sages au sens socratique du terme : ils ont conscience de la limitation ou de l’imperfection de leur savoir. C’est pourquoi ils sont tout à fait disposés à s’informer afin de se faire une idée précise sur le sujet. Logiquement, travailler en assemblée consiste alors tout d’abord à donner la parole aux différents points de vue sur la question afin de brosser un tableau de la situation le plus exhaustif possible. Ce ne sont plus des « experts », des « chefs de cabinet » ou des « communicants » choisis pour leurs opinions qui indiquent au décideur la position à adopter. Nulle pression de lobby n’est en outre possible : comment influencer tant de personnes ? Simplement, les citoyens et les citoyennes écoutent tour à tour des chercheurs, des militants, des membres d’associations, des responsables d’entreprise, des salariés, etc. Après ce moment permettant à chaque membre de devenir éclairé sur le sujet, on fait émerger des propositions ou des décisions à la suite de discussions et de votes. D’ailleurs notre personnel politique connaît très bien ces véritables dispositifs démocratiques : lorsque la Convention Citoyenne pour le Climat est installée, le Président sait très bien ce qu’il fait. Il se donne l’image d’un démocrate après le mouvement des gilets jaunes, et ensuite il enterre le rapport avec le plus grand cynisme.
Pour synthétiser notre pensée, on pourrait proposer le petit tableau suivant qui distingue deux types d’homme (ou de femme) politique :
| HOMME POLITIQUE | |
| Il est élu comme représentant | Il est tiré au sort parmi l’ensemble des citoyens pour former des assemblées représentatives |
| Oligarchie | Démocratie |
| Il croit savoir | Il sait qu’il ne sait pas |
| Le pouvoir confirme son orgueil | Sa charge l’intimide |
| Il décide à partir de ses présupposés | Il prend des décisions éclairées |
| Influençable | Difficilement influençable |
Au final, on comprend que pour des démocrates, l’intelligence est évidemment le fruit d’une réflexion collective ; tout prétendu « sauveur » serait regardé de travers, comme un élément voulant influencer ses concitoyens afin de leur imposer ses vues. Dans ces conditions, pour répondre à votre question : que penser d’institutions qui peuvent, par la volonté d’un seul homme, contre les députés, contre les syndicats, contre 80% de la population active, faire passer une réforme reculant de deux ans l’âge de départ en retraite ?
- De l’hypothèse démocratique, vous expliquez comment elle pourrait advenir, dès lors qu’il y aurait des principes (de participation), des institutions (d’auto-contrôle, de limitations des pouvoirs). Par comparaison avec la situation française, comment sortir de la « nasse » représentative et commencer par des pratiques démocratiques fondamentales ?
On peut en effet insister sur la difficulté d’instaurer une véritable démocratie comme m’y poussait l’une de vos questions précédentes, mais on peut aussi essayer de construire des propositions simples et efficaces pour parvenir à nous en approcher. C’est justement ce que propose mon livre en développant une idée qui peut paraître assez dérisoire : remplacer l’élection des délégués de classe à l’école par un tirage au sort. L’école est en effet un creuset pour inventer une société nouvelle. Au lieu d’en faire un lieu d’apprentissage des normes et des conventions afin que les futurs citoyens ne fassent que reproduire les us et coutumes des générations précédentes, on pourrait la voir comme un lieu d’émancipation dans lequel des pratiques véritablement démocratiques pourraient être expérimentées.
L’élection est en effet une pratique proprement aristocratique qui consiste à désigner ceux qu’une majorité considère comme les meilleurs. Cela peut être très utile lorsqu’on a besoin de mettre des personnes qui possèdent des compétences particulières en responsabilité de fonctions spécialisées. Mais en l’occurrence, pour être délégué de classe, c’est-à-dire principalement être le porte-parole de la classe, pourquoi tous les élèves ne pourraient-ils pas être capables de l’apprendre en l’expérimentant ? Et si on reconnait une égale capacité de tous les élèves pour apprendre cette fonction, pourquoi ne pas tirer au sort ? Finalement, organiser des élections de délégués, c’est priver la majorité des élèves d’un apprentissage tout en les habituant à l’idée que certaines personnes peuvent accéder à des responsabilités auxquelles la plupart ne peut prétendre. C’est tout bonnement construire une impuissance, une résignation : on habitue les futurs citoyens à renoncer à leur souveraineté et à penser que faire de la politique est une profession réservée à quelques-uns. Au contraire, décider de tirer au sort les délégués, c’est affirmer une égale puissance, une capacité égale de tous les élèves pour s’occuper du bien commun (ici les affaires de la classe). C’est semer le principe de l’égalité politique de tous les citoyens lorsqu’il s’agit d’organiser la vie en société.
- Votre livre se termine par des extraits d’un entretien d’Emmanuel Macron, auquel vous vous adressez. Le livre est paru il y a deux ans, 4 ans après sa première élection. Depuis, il a été réélu. Votre propos, très synthétique (à l’instar de tout le livre), est très sévère. Mais plutôt que d’en dévoiler le contenu, comment prolongeriez-vous votre propos, étant donné ce que les deux années, postérieures à la parution du livre, nous ont appris sur ce président de la 5ème République ?
J’ai eu en effet quelques retours sur cette conclusion… Jusque là, mon livre est un essai de philosophie politique qui cherche à définir ce qu’est véritablement la démocratie et comment le mot est devenu peu à peu synonyme d’oligarchie avec un tournant vers le début du XIXème siècle. Puis, dans une seconde partie, je montre comment l’introduction du tirage au sort des délégués de classe à l’école pourrait être l’occasion d’expliquer théoriquement cette distinction tout en expérimentant un usage proprement démocratique. A l’issue de cette réflexion, il est bien probable que certains lecteurs prennent conscience que, tout compte fait, ils ne sont pas forcément démocrates. Et après tout pourquoi pas ? J’ai ainsi conçu ma conclusion comme une mise au point beaucoup plus crue, plus explicite de l’enjeu de la définition de cette alternative à nos institutions. Et donc, concrètement, être démocrate aujourd’hui en France, c’est s’opposer à la figure de celui qui a été élu pour incarner le Président de la République. On pourrait le dire de tous les politiciens depuis la Révolution française, à quelques exceptions près. La réflexion de philosophie politique se frotte au réel et peut apparaître alors plus « polémique », alors que ce n’est que la conséquence de ce qui précède : la démocratie est le poil à gratter de tous les pouvoirs, elle est la détestation de toutes les figures qui ont choisi d’incarner la confiscation du pouvoir et qui se posent au dessus du peuple.
Il me semble que, malheureusement, ces deux années ne font que confirmer l’analyse de ma conclusion. Ces deux mandats révèlent à quel point les institutions de la Vème République sont peu démocratiques : en effet, comme le gouvernement ne cesse de le répéter, leur manière de « réformer le pays » est légale. C’est bien ça le problème ! Qu’on puisse passer outre les mouvements sociaux, les syndicats, les députés, utiliser la police pour décourager la contestation, etc. Face à cette manière de gouverner, en tant que citoyen, j’ai juste un sentiment d’infini : je me demande quand est-ce que ça va s’arrêter ? Car à la casse des acquis sociaux s’ajoute la libération des paroles et des actes racistes. Alors oui, dans nos institutions, c’est le Président qui est le premier responsable. Or j’ai l’impression que le citoyen Emmanuel va toujours plus loin dans l’arrogance, dans le mépris, dans l’utilisation de la force… Comme dans une spirale infernale : plus il passe en force et plus il a le sentiment d’être tout puissant. Alors qu’il devrait au contraire faire preuve d’humilité, trouver des compromis, il se raidit de plus en plus semblant préparer la France à l’instauration d’un régime fasciste. « Comment l’arrêter ? » est la question qui m’obsède. Mais je crois que je ne suis pas le seul…
Et comme je suis bien conscient que le problème ne réside pas dans la figure concrète de tel ou tel homme politique, qu’après lui il y en aura un autre et qu’il (ou elle) pourra être pire, mon propos n’est pas d’écrire un pamphlet politique mais de me demander plus largement : comment se passer de Président ?
- La deuxième partie du livre prend appui sur l’école pour en faire un cas d’étude de la différenciation entre représentation et démocratie, centrée sur l’élection des délégués Or, avec les politiques engagées ces dernières années, et confirmées par le Ministère de l’Education Nationale qui vient de partir, comme par celui qui a pris sa succession, l’Etat a fait prendre à l’Education Nationale le chemin inverse, notamment pour les professeurs. Une Éducation enfin démocratisée, a contrario, ce serait… ?
Vous m’interrogez pour finir sur un sujet très vaste que je ne traite pas du tout dans mon livre et qui demanderait un travail spécifique. En effet, on assiste pour l’école à ce qui se passe dans tous le domaine public : en France, depuis 1982, les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de faire reculer toutes les droits sociaux et politiques du pays. C’est la revanche du capitalisme, certains diront du néo-libéralisme, sur les droits acquis de hautes luttes par les travailleurs et les citoyens pour construire une instruction obligatoire, laïque et gratuite, la sécurité sociale, le salaire des retraités et des chômeurs, ainsi que tous les services publics : La Poste, la SNCF, EDF, GDF, France Télécom, etc. Toutes ces activités ont été retirées de la logique capitaliste dans l’histoire : plus moyen de faire de l’argent avec l’éducation, la santé, l’énergie etc. ! Cela est insupportable pour le capitalisme et on assiste donc, depuis plus de 40 ans, au grignotage constant et inlassable du privé sur le public. Quel rapport me direz-vous entre l’extension du capitalisme et le démantèlement de la démocratie ? En effet, à écouter Jacques Attali et tous les nigauds de son espèce, l’extension du capitalisme permet au contraire celle de la démocratie ! Pourtant, le capitalisme se fonde sur la possession d’un titre (celui de la propriété du capital) pour justifier le pouvoir sur tous les travailleurs. Travailler, en capitalisme, c’est se mettre au service de l’accroissement du capital des propriétaires. Impossible, dans un tel rapport inégalitaire, de construire une société démocratique.
L’enseignement, en tant que service public, devrait être en dehors de cette logique. Oui les enseignants travaillent, mais pas au sens capitaliste du terme : ils sont souverains sur l’organisation de leurs cours et la valeur de ce qu’ils produisent n’a rien à voir avec l’accroissement d’un capital. Comme je l’ai compris en étudiant Bernard Friot, ces conquêtes proprement communistes sont attaquées petit à petit, et cela passe, en ce qui concerne l’Éducation Nationale, par la privatisation progressive de l’enseignement et l’instauration de logique managériale néolibérale au sein des écoles, des collèges, des lycées et des universités. Par exemple, à la rentrée, les enseignants pourront décider de signer le fameux « pacte » actant ainsi l’idée qu’au lieu d’être rémunéré grâce à leur qualification, ils reviendraient à un salaire de nature capitaliste : à la tâche.
Face à ce bulldozer libéral, comment imaginer « une Éducation enfin démocratisée » me demandez-vous ? Pour ma part, en tant que professeur de philosophie : en maîtrisant et en enseignant à mes élèves l’expression d’une alternative au capitalisme, à la fois communiste, écologique et démocratique. Afin de permettre à un maximum de citoyens de se saisir dans un futur plus ou moins proche de situations d’extrêmes tensions, soit à cause d’une énième crise du capitalisme mondialisée, d’une guerre civile suite à l’accession au pouvoir de l’extrême droite ou de cataclysmes climatiques, afin d’être en capacité d’en finir avec cette folie du diktat de la croissance infinie qui rend absurde notre travail et détruit notre planète.
1 Le chiffre de 20% correspond au nombre de citoyens pouvant participer à l’Ecclesia (6.000) par
rapport au nombre total de citoyens (30.000). Mais si on ajoute la population qu’on considère
aujourd’hui comme « citoyenne », c’est-à-dire les femmes et les esclaves, on arriverait
approximativement à 150.000 citoyens athéniens. Donc 6000 sur 150.000, cela ferait tout de même
4%. Comparés au 577 députés et 348 sénateurs, soit 925 individus, sur une population de citoyens
d’environ 52 millions (Français en âge de voter) aujourd’hui, cela représente 0,0018%, soit 2.000 fois
moins !
2 Hansen, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, Tallandier, 2009, p.356.