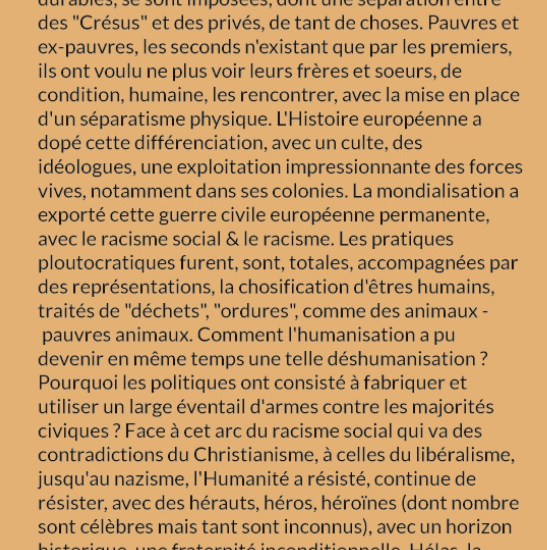Socrate et Platon furent des Athéniens de l’Athènes à son crépuscule, ce dont ils eurent l’intuition, ce contre quoi ils travaillèrent, s’opposèrent, échouèrent. Leur conscience, leurs propos, exprimés dans un présent (éternel temps de la vie humaine), étaient fondés sur les legs de cette Histoire, athénienne comme grecque, la langue, les récits (mythes, légendes, premiers récits historiques), l’ensemble d’une mémoire, de leurs ascendants vivants, de leurs amis, de leurs formateurs. Les siècles antérieurs, notamment de la période archaïque, étaient ainsi impliqués et concernés par cette mémoire (1). Or, pendant ces siècles, la civilisation grecque formée par des cités et des communautés paysannes, de pêcheurs, a connu des changements majeurs, en les modifiant radicalement, que cela soit par leur démographie comme par leurs principes politiques. La culture grecque est devenue celle des violences, partout, externes (externalisées par les soldats grecs), comme internes, par la fin de la fraternité communautaire historique, sous l’effet de plusieurs causes qui ont interpellé leur conscience, leur volonté, jamais vue, de comprendre, expliquer (et non justifier), pour s’en sortir. Il est fréquent de faire référence aux épopées homériques, « L’Iliade » et « L’Odyssée », comme si ces récits, tellement « connus », allaient de soi, faisaient partie de notre propre Histoire culturelle, et relataient des voyages de guerriers-philosophes, qui se posent des questions sur qui ils sont et ce qu’ils font… Or leur mise en perspective respective révèle leur étrangeté : « L’Iliade » conte une partie du temps d’une expédition militaire d’une coalition grecque, au prétexte de venger un affront royal subi par l’enlèvement d’une Reine, contre la cité originaire du voleur, une autre cité grecque. Des détails sur cette guerre, de ses débuts à sa fin, sont énoncés dans « l’Odyssée » et circulaient dans la tradition orale, comme le siège meurtrier pendant dix ans, le faux départ de la coalition, l’entrée dans la ville, l’ethnocide des habitants de Troie par des Grecs enragés. Et « L’Odyssée » ajoute ses propres violences, comme le massacre des « prétendants », ces hommes qui convoitaient l’épouse d’Ulysse, Pénélope. La violence est ontologique dans cet Univers grec : entre Dieux et Déesses, entre Dieux et humains, entre « monstres » et humains, et entre humains. De « mythe » fondamental, « l’Iliade » et « l’Odyssée » finissent par devenir l’Histoire grecque, permanente. Les cités grecques sont instables (et pourquoi ?), mais pour nombre de leurs habitants, construire une stabilité durable sur laquelle il devenait possible de construire restait un objectif prioritaire, nécessaire. Nombre ne se résignaient pas à cette violence, politique, sociale, permanente.
Un des premiers à avoir conçu un projet, « plan », politique, fut Pythagore, et ce n’est pas un hasard si, selon la légende, il aurait été le premier à utiliser le terme de « philosophe » pour se qualifier lui-même, en réponse à une question, « qui est-tu, toi, Pythagore ? » (Toi, le… woke !, l’éveillé !). En effet, un des premiers penseurs des plus grandes abstractions possibles (les nombres, cette anti-évidence !), en a conclu que l’Univers était une harmonie musicale, et qu’il fallait construire des cités humains « à l’image du cosmos » – nous sommes à une époque où les nombres ne servent pas seulement à l’omniprésente comptabilité générale, pour justifier que « la politique », tombée entre les mains de gestionnaires avares et de racisme social, soit réduite à la conscience et à l’enfermement des colonnes de débit et de crédit. La proposition pythagoricienne, « l’harmonique/harmonisation sociale », est formulée AVANT le temps de la vie des Socrate et Platon, et son influence sur ce dernier, souvent citée, est sous-estimée, y compris parce que, de la vie de Pythagore, des communautés pythagoriciennes, des cités sous la loi pythagoricienne, nous savons, hélas, si peu. Et, hélas encore, la dite proposition n’est pas un succès durable. Elle a eu le mérite de démontrer qu’il était possible que les cités soient collectivement dirigées, et qu’elles le soient sous l’influence d’hommes intéressés aux choses même, de la Terre et du Ciel, des « sages » ET savants, et non des rois… tyrans. L’échec du projet pythagoricien est un échec pour la stabilité, et l’Histoire d’Athènes en est la démonstration, terrible. Des « hommes d’influence » y deviennent puissants, et incitent les Athéniens à soutenir leurs propositions, décisions, notamment par la promotion de la « garantie », sortie, guerrière : aller prendre aux autres ce qui leur appartient, et vendre. Piller, tuer, mettre en esclavage. Autrement dit, pratiquer, même à petite échelle, ce que les Grecs d’Achille, Agamemnon, Ménélas, Ulysse, avaient fait, à et contre Troie, jusqu’à sa destruction même, un acte pourtant impie.
« L’impérialisme athénien », hélas, encore une fois, ne fut pas une légende. Mais pour Socrate et Platon, ne pas respecter ses devoirs humains, les lois humaines les plus fondamentales, les « lois sacrées », peut, sur le moment, donner l’impression d’un « gain » (une victoire militaire), mais se paye cher, à un moment ou à un autre. Du point de vue de la « comptabilité », le crédit momentané est plus léger que le débit durable, surtout si celui-ci est, ni plus ni moins, que la ruine de la cité, sa disparition. On ne plaisante pas avec les principes. Or, eu égard à ce sacré, expression de l’Universel, en lien avec le principe du Bien, Socrate et Platon sont les témoins de la montée en puissance d’incrédules, qui croient à autre chose, notamment à ce qui, ici et maintenant, donne une « puissance » : comme l’or, la monnaie. Depuis le modèle de Crésus, les « nouveaux riches » grecs sont, déjà, en sécession, avec leur cité, leurs « frères », qu’ils ne connaissent plus, ne reconnaissent plus, alors qu’ils sont immédiatement des amis d’autres ploutophiles/ploutocrates comme eux, étrangers. La « Philia », si essentielle dans la structuration de la communauté à laquelle tout Grec appartient, est ainsi foulée aux pieds, comme oubliée. Et des familles aristocratiques se sont laissées séduire par leurs nouveaux amis, en acceptant de soutenir la logique politique qui les fonde et qu’ils promeuvent : s’enrichir, toujours plus, sans limite. C’est DANS UN TEL MONDE, dans un tel cadre, historique, politique, que Socrate naît, que Platon naît, qu’ils grandissent, et qu’ils assistent à l’éloge permanent des « importants », bien que, de leur pensée, de leurs décisions, la ruine future pour tous soit certaine (cf. l’article de Vincent Azoulay, « Violente amnistie. La réconciliation athénienne après 403 av. J.-C » paru dans « Annales, Histoire, Sciences Sociales, 2019/2« ))(2). Le schéma ploutocratique de l’ascension brutale/chute brutale, comme représentée il y a peu dans l’Histoire européenne, par le nazisme, est constant, et bien qu’il soit connu, que son sort soit systématique, nécessaire, il peut compter sur des fanatiques hypnotisés pour le justifier et l’animer. Face à ce danger d’une Histoire qui se confond avec la tragédie, avec un Oedipe qui importe dans une cité la peste, l’un et l’autre ont oeuvré : Socrate, par sa vie, Platon, par sa vie, par les Dialogues, par l’Académie, première école/Université, gratuite, y compris pour les femmes – ce qui, à Athènes, dans cette Grèce antique, est proprement révolutionnaire. Ce à quoi ils oeuvrent, séparément et « ensemble » (dans le couple fictif qu’ils forment, par le Socrate de Platon, dans les Dialogues), c’est de « détyranniser » (3) les cités, en faisant disparaître les racines tyranniques, au maximum. Mais là où nous disons dans un même sens, déradicaliser, la « tyrannie » est un problème consubstantiel à la psyché humaine, et à l’addition de ces psychés, avec les communautés : là où nos « déradicalisations » ne visent que des individus en tout petit nombre, toujours réduits à du « terrorisme », d’origine exogène, la tyrannie est la cinquième colonne par laquelle chaque citoyen peut trahir, et l’Humanité, et la cité, si… Et cette tyrannie, Platon en a identifié une forme « nouvelle » (déjà en vigueur dans le monde grec depuis quelques générations), susceptible de bénéficier d’un dynamisme ultérieur impressionnant, avec les ploutophiles, incarnés par cette famille qui accueille Socrate au début de « Politeia », « La République ». Si la « tradition » interprétative européenne des Dialogues a eu tendance à ne pas prêter attention à leur mise en scène, aux personnages, aux situations, il n’est plus possible de continuer dans cette aporie, dès lors qu’il est possible de démontrer le lien entre ces éléments et des thèmes explicites et importants d’un Dialogue : ainsi, dans « La République », entre cette famille, d’artisans, qui fabriquent des armes, les vendent, à Athènes, pour ses victoires ET EN FAIT, sa perte, et ce que Platon dit des mauvais régimes, au début du Livre VIII, dans lesquels les « gens d’armes » jouent un rôle central, du début à la fin. Et que disent, Céphale, puis Polémarque, puis Thrasymaque ? Il faut les lire, pour entendre les Trump, Javier Milei, de notre temps : je veux être puissant/riche, QUOI QU’IL EN COUTE, et ce, SANS LIMITE. Un discours « inhumain », puisque, humainement, tout est limité. Une dérive civique, quand des humains entendent vivre « comme » des Dieux. Sur de telles bases, l’Histoire européenne partait mal. Et elle a mal tourné. Enfin, elle a fait mal tourner l’Histoire du monde ET elle continue, tant en Europe que dans ses ex et toujours colonies (en particulier, en Amérique du Sud, Amérique du Nord). C’est le sens du travail publié dans le livre « Racisme social… » : parler de cette Histoire-catastrophique, l’Europe maudite, et si dangereuse pour les peuples des autres aires.
Les conséquences de ce réinterprétation du sens originaire de la pensée philosophique sont multiples : tant pour la compréhension, globale comme dans son détail, de l’oeuvre « Philosophie », de Platon, que de ce que nous appelons « l’Histoire de la Philosophie », mais aussi, en Histoire, de la manière de raconter et d’interpréter celle de l’Europe et des autres peuples du monde.
(1) cf. les ouvrages de Françoise Ruzé, « Délibération et pouvoir dans la cité grecque, de Nestor à Socrate » https://books.openedition.org/psorbonne/23745?format=toc, de Julien Zurbach, « Les hommes, la terre et la dette en Grèce, c.1400-c.500 av JC » (Ausonius, Scripta antica, 2022)
(2) « A la fin du ve siècle av. J.-C. s’acheva « la plus grande crise qui émut la Grèce et une fraction du monde barbare, puisqu’elle gagna pour ainsi dire la majeure partie de l’humanité ». Conçue comme un seul et long conflit par Thucydide, la guerre du Péloponnèse (431-404 av. J.-C.) aboutit à la défaite d’Athènes et à la dislocation de son empire maritime. Longtemps marginalisés, les oligarques athéniens profitèrent de la débâcle pour prendre leur revanche dans la cité : avec l’appui des troupes spartiates, une commission de trente Athéniens mit fin aux institutions démocratiques qui régissaient le fonctionnement de la vie politique depuis plus d’un siècle. Sous la conduite de Critias et de Chariclès, les Trente réduisirent drastiquement le corps civique – désormais limité à trois mille citoyens – et multiplièrent les exécutions sommaires, les spoliations arbitraires et les bannissements collectifs. Face à ces exactions, les démocrates ne restèrent pas sans réagir : dès la fin de l’année 404, Thrasybule rassembla une armée de volontaires, composée de citoyens athéniens exilés, de métèques et même d’esclaves. Partie de Thèbes, cette troupe hétéroclite s’empara d’abord de la forteresse de Phylè dans le nord de l’Attique, avant de prendre le contrôle, quelques semaines plus tard, du port stratégique du Pirée. Profitant de l’attentisme des Spartiates et des dissensions au sein de l’oligarchie, « ceux du Pirée » remportèrent alors plusieurs victoires retentissantes sur « ceux de la Ville ». Si les négociations se révélèrent longues et difficiles, la réconciliation fut conclue au début de l’automne 403. Le 12 de Boédromion, l’armée de Thrasybule entra en Ville et se rendit en procession jusqu’à l’Acropole pour sacrifier à la déesse Athéna. Puis, redescendant vers la Pnyx, les stratèges convoquèrent une assemblée au cours de laquelle tous les Athéniens s’engagèrent à respecter les termes de la réconciliation et, dès lors, « la vie publique reprit son cours. À leur retour, les démocrates victorieux firent ainsi preuve d’une grande retenue. Les deux camps jurèrent solennellement de « ne pas rappeler les maux » (mē mnēsikakein) ou, plus précisément, de « ne pas garder rancune », une injonction souvent considérée comme l’une des toutes premières amnisties de l’histoire. Amnistie, non pas amnésie : Nicole Loraux, dans un livre célèbre, a montré que ce serment correspondait à une forme paradoxale de mémoire – une mémoire refusée ou, pour le dire autrement, un oubli mémorable. Pour conjurer le spectre hideux de la guerre civile (stasis), les démocrates auraient fait le choix d’oublier et, en quelque sorte, de se souvenir qu’ils devaient oublier ce moment traumatique. Loraux y voit une décision éminemment politique, reprenant la formulation même de la Constitution des Athéniens à propos de l’amnistie de 403 : « il semble bien que [les Athéniens] aient usé de leurs malheurs passés de la façon la plus belle et la plus politique [politikotata] ». C’est que le politique, pour l’historienne, s’identifie tout à la fois au conflit et à son nécessaire refoulement. Le serment d’oubli de 403 en offre un saisissant condensé en ce qu’il promeut le refoulement actif de la guerre civile et, en même temps, en affiche la trace, comme un membre amputé attire tous les regards. Cet article propose de tester l’hypothèse du politique comme refoulement du conflit à partir du terrain même qui lui a servi de matrice. Il prend comme point de départ (…) « .
(3) remerciement aux lectrices et lecteurs pour votre mansuétude concernant ce néologisme